Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo
Gallimard, août 2016
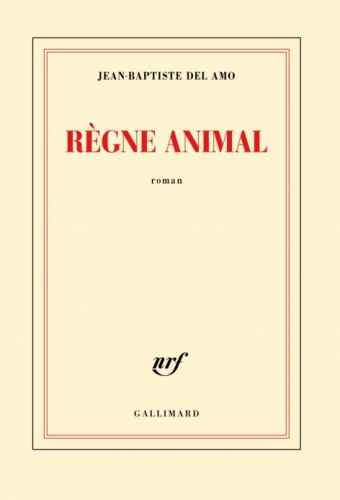
432 pages, 21 €
On pourrait résumer Règne animal en disant que ce roman révèle l’humanité des animaux en exposant la bestialité des hommes qui les ont forcés à vivre avec eux, pour les servir, les nourrir, les faire vivre et les enrichir au fur et à mesure qu’eux-mêmes sont engraissés, transformés. C’est aussi l’histoire d’une famille rurale qui vit à la marge d’un petit village du Sud-Ouest de la France, nommé Puylarroque. Une histoire qui couvre un siècle, naturaliste à l’extrême, tout à la fois lyrique et organique, la chair, le sang et tous les fluides possibles que peuvent laisser échapper les corps, animaux comme humains, la merde et la décomposition, étant comme omniprésents.
L’histoire commence au début du siècle dernier, chez des petits paysans, avec un lopin de terre, quelques animaux, une porcherie, un père qui meurt lentement d’une grave maladie tout en continuant à travailler, une survie des plus rudimentaires, la mère que cette rudesse extrême, le dénuement, la frustration, a rendu mauvaise, dure et sèche comme un cal, et une petite fille en qui persiste un peu de rêve.
La fillette grandit entre les corvées et le joug maternel impitoyable, mais s’échappe dans la douceur de son imagination. Le père est à l’agonie, il fait appel à Marcel, un jeune cousin éloigné de la famille, pour l’aider et au final le remplacer. Un étranger malvenu pour la mère, un peu d’oxygène pour Éléonore, de la tendresse, de l’amitié, puis des émois, le désir naissant et puis soudain, la guerre. Celle de 14, celle dont Marcel ne reviendra pas, ou pas complètement, pas entier.
Ça c’est la première partie, La sale terre (1898-1914), première partie d’un roman qui est un peu comme débité en morceaux, par des évènements extérieurs qui viendront ravager des conditions et des existences déjà précaires et qui ont tous pour point commun une colossale violence : les guerres, les désastres économiques et le rouleau compresseur du chamboulement industriel. Violence des hommes faite aux hommes et celle des hommes faite aux animaux qui partagent leur sort : l’exploitation animale est en effet le cœur de ce roman, mais les bourreaux, on le voit, vont de même à l’abattoir, un cercle infernal. Et c’est bien où nous conduit ce roman, en enfer, et l’auteur nous y contraint d’une certaine façon, le chemin se fait de plus en plus étroit, la fuite impossible et nous voilà le nez dans notre propre merde.
Une écriture exceptionnelle que celle de Jean-Baptiste Del Amo : en plongeant sa plume dans le fumier, il nous offre un véritable chef-d’œuvre. Le ton halluciné et l’univers peuvent faire songer au Livre des nuits et à Nuit d’ambre de Sylvie Germain, mais ici sans aucune échappée dans l’irréel ou l’onirisme. Même la religion n’offre aucune transcendance, chacun s’arrangeant de ses seules apparences, derrière c’est le vide, et l’enfant de chœur préféré du curé ivrogne sera retrouvé pendu à un grand chêne. Ici le réalisme est implacable et il pue, comme cette ruralité profonde où l’imaginaire n’a à voir qu’avec le diable. L’auteur s’est livré ici à un grand travail de recherche, le sujet est fouillé, creusé, jusque dans les moindres détails, avec des descriptions d’une précision chirurgicale, d’abord de cette vie rurale au tout début du XXème siècle, et puis l’abomination de la Première Guerre qui vient chercher les hommes et les très jeunes hommes qui n’avaient jamais mis les pieds hors de leur campagne, pour les plonger brutalement dans une boucherie abominable et avec eux, toujours et encore, les animaux. Post tenebras lux (1914-1917).
Puis il y aura l’après-guerre, les choses qui ne seront jamais plus les mêmes, puis une autre guerre encore et la suite, sur lesquelles il y aura comme une grande ellipse. Marcel, le cousin d’Éléonore, devenu un mari et un père refermé à jamais sur sa blessure immonde, qu’il noie dans l’alcool et le travail, la refusera cette fois de toute ses tripes.
Et puis c’est la bascule dans le monde moderne et toujours, la même ferme, au même endroit, « La harde » menée par Serge, fils de Marcel, qui incarne le pivot entre deux mondes, inculquant à ses deux fils une profonde défiance et le refus de ce qui est extérieur au clan, tout en étant obsédé par la réussite. Nous sommes en 1981, et la seconde moitié du roman, après nous avoir fait parcourir presque un siècle, se déroule sur cette seule année fatidique dans l’univers dantesque d’une exploitation porcine intensive mais encore familiale. La petite-fille du début du roman, Éléonore, maintenant grand-mère et arrière-grand-mère, est toujours là, vivant recluse et taciturne dans une partie du corps de la ferme qui tombe en décrépitude au profit des bâtiments de la porcherie moderne. Entourée de ses innombrables chats, elle vit à l’écart des autres membres du clan, coupée d’eux pour avoir été trop témoin de la folie des hommes, celle de sa propre mère, puis de son mari et dans la foulée son fils, qui a repris le flambeau d’une sorte de tare ancestrale qui semble les lier pour toujours aux porcs.
Seul son petit-fils Jérôme, étrange et mutique lui aussi, a une forme de lien avec elle, les deux étant plus proches de la nature, plus humains et donc plus proches de leur animalité. C’est ce paradoxe qui ressort de ce roman terrible. Le thème central est bien cette folie de l’homme à vouloir asservir, exploiter le vivant au-delà de toutes limites, une dérive complètement démente qui signe sa propre perte.
Et en cela, ce roman nous interroge en profondeur sur le sens de tout ça. Il ne peut que renforcer la détermination des végétariens, des végans – qui peut-être n’en supporteraient même pas la lecture, et dans une vision moins catégorique, de tous ceux qui aujourd’hui soutiennent qu’il faut revenir à de tous petits élevages à taille humaine, à condition toutefois d’y respecter l’animal bien plus qu’on ne l’a jamais fait, mais comme le font aujourd’hui encore certains peuples autochtones, qu’on dit primitifs. Mais, y’a-t-il quelque chose de plus primitif au sens péjoratif du terme, de plus primaire, de plus barbare, que les élevages intensifs et industriels ? Plus ignorant que cette méconnaissance et ce mépris total de la sensibilité et de la souffrance animale ?
Alors oui, Règne animal est un chef-d’œuvre de littérature, mais qui au-delà nous interroge et nous questionne sur quelque chose d’essentiel : qu’est-ce que l’humanité ?
Cathy Garcia
 Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981), vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures. En mars 2009, Jean-Baptiste Del Amo se voit finalement attribuer la Bourse Goncourt du premier roman, à l'unanimité dès le premier tour de scrutin. Le 25 juin 2009, c'est au tour de l'Académie française de lui décerner le prix François Mauriac. Ont suivi Sel en 2010 et Pornographia en 2013, Règne animal est son quatrième roman.
Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981), vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures. En mars 2009, Jean-Baptiste Del Amo se voit finalement attribuer la Bourse Goncourt du premier roman, à l'unanimité dès le premier tour de scrutin. Le 25 juin 2009, c'est au tour de l'Académie française de lui décerner le prix François Mauriac. Ont suivi Sel en 2010 et Pornographia en 2013, Règne animal est son quatrième roman.
Commentaires
Légère correction : le fils de Marcel et d'Eléonore est Henri (du nom du patriarche), Serge étant son petit-fils.
merci pour ces rectifications, je me suis emmêlée les générations