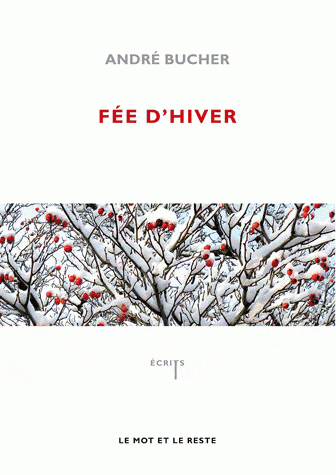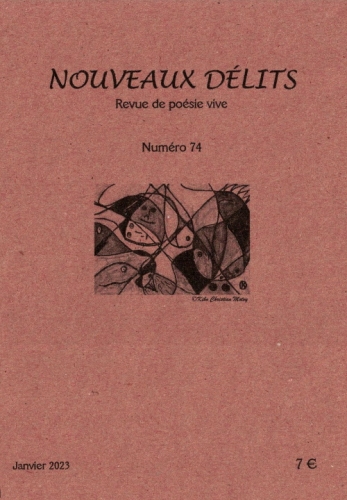En hommage à l’auteur qui s’est envolé vers le territoire d’au-delà le 1er octobre dernier et qu’il ne sera jamais trop tard de lire, une note de lecture rédigée en 2012.
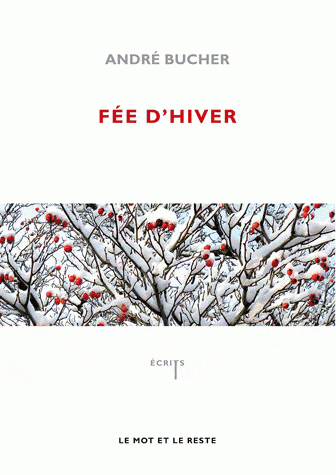 Fée d’hiver d’André Bucher. Le Mot et le Reste, décembre 2011
Fée d’hiver d’André Bucher. Le Mot et le Reste, décembre 2011
Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas encore le talent d’André Bucher, voici une bien belle façon de le découvrir. Dans Fée d’hiver, on sent le souffle d’un Jim Harrison, dont André Bucher est grand lecteur, mais l’écriture de cet écrivain poète paysan est unique. Elle sent le vécu, le territoire arpenté, la solitude affrontée. Fée d’hiver est un roman à la fois âpre et magnifique, austère et puissamment physique, comme les lieux dans lesquels il prend place dans ce sud de la Drôme, à la limite des Hautes-Alpes. Des lieux sauvages, entourés de montagnes, désertés par les hommes partis rejoindre les villes, où la vie, croit-on, offrirait plus de facilités.
Le roman démarre sur un prologue, un article paru dans le journal Le Dauphiné libéré, daté du 31 août 1948. Un fait divers, « Drame de jalousie dans le sud de la Drôme », qui fait écho au titre du livre : Fée d’hiver. Cette fée d’hiver qui vient comme pour rompre une malédiction, une sorte de réparation d’accrocs dans les mailles du destin.
La première partie du roman est un journal intime à deux voix, s’étalant entre 1965 et 1988. Une façon de présenter les lieux, le contexte, les personnages. Daniel et Richard sont deux frères, l’un géant et l’autre court sur pattes, l’un parle peu, l’autre ne parle plus du tout. Ce sont les deux enfants laissés orphelins par le drame familial évoqué dans l’article du journal. Placés en famille d’accueil par la D.D.A.S.S., ils ont grandi et retournent maintenant vivre dans la ferme familiale aux Rabasses, pas très loin du village de Laborel. Une ferme délabrée, que Richard, l’ainé, va peu à peu transformer en casse. Daniel lui, muet depuis le drame, s’occupe d’un troupeau de brebis. Deux marginaux en quelque sorte, repliés sur eux-mêmes, que les gens alentour prennent pour des attardés.
Et puis il y a les Monnier qui ont une scierie. Le père était l’amant de la mère de Richard et Daniel, responsable en quelque sorte de leur malheur, mais il est mort lui aussi, emporté par un cancer peu de temps après. Restent les deux fils, dont l’ainé dirige maintenant la scierie et le cousin Louis, le nabot que les frères Monnier aimaient tant tyranniser quand ils étaient encore enfants. Ces deux-là depuis toujours enclins à la morgue et à la méchanceté et la vie n’avait pas aidé à les changer.
Heureusement il y a Alice, la jeune sœur. Alice travaille comme secrétaire à la scierie de ses frères, elle part à midi ravitailler les bûcherons. Alice est différente et elle n’a pas peur de passer du temps avec Daniel, le mutique des Rabasses, quand il fait pâturer ses brebis. Elle passe le voir, cherche à communiquer avec lui. Bien qu’elle soit bien plus jeune que lui, Daniel l’aime beaucoup, seulement les années passent vite. Un jour, alors qu’Alice a déjà plus de trente ans, elle finit par dire oui au cousin Louis. Daniel décide alors qu’il ne parlera vraiment plus jamais et arrête son journal. Nous sommes en 1988.
Le roman enchaîne alors sur l’histoire de Vladimir entre 1995 et 1998. Vladimir est serbo-croate et bûcheron. En 1995, avant le cessez-le-feu entre les Serbes et les Bosniaques, sa sœur et ses parents périssent dans la destruction de leur village. Vladimir, c’est son métier qui l’a sauvé, il était dans la montagne en train de bûcheronner quand c’est arrivé. Quand il est revenu, il n’y avait plus rien, juste larmes, cendres et décombres. Il a donc fui, son pays, ses souvenirs, sa douleur. De pays en pays, une vie rude et solitaire d’exilé, de sans-papier, avec pour seul bagage, seul lien avec son passé, une anthologie bilingue de poésie des Balkans. Il exerce son métier partout où il peut et de pays en pays, finit ainsi par arriver en France. Dans le parc du Lubéron, il travaille comme surveillant d’incendies avec Alain, un étudiant qui prépare une thèse sur l’éclatement de la péninsule des Balkans et parle donc un peu la langue de Vladimir. Ainsi, tout en guettant les feux, débroussaillant, éclaircissant les bois, il aide ce dernier à perfectionner son français. Le Lubéron hors saison touristique est totalement dépeuplé au grand étonnement de Vladimir.
« — Et encore, tu n’as rien vu. Ici ça va, on est dans le Lubéron. Passe seulement de l’autre côté du plateau d’Albion, en redescendant jusqu’à l’extrême pointe Sud de la Drôme, à la limite des Hautes-Alpes, tu verras… c’est bien pire. Là-bas même les corbeaux sont inscrits sur les listes électorales. Par contre en tant que bûcheron, tu devrais pouvoir trouver. Plus personne ne veut faire ce boulot. »
C’est comme ça, qu’en mars 1998, quelques mois après la fin de leur contrat, Vladimir se retrouve face à Alice devant la scierie des Monnier.
« — Bonjour Madame. Je m’appelle Vladimir, je suis bûcheron et je cherche du travail. »
Entre temps, Alice, avait donc vécu sa vie de femme mariée. Mariée moins par amour que par peur de rester seule et aussi sous la pression de ses frères, histoire que la scierie reste en famille. Le petit Louis était devenu un homme, toujours aussi faible mais plus sournois et puis il s’était mis à boire, à boire et à frapper.
Alice était loin, bien loin de ses rêves. Après huit années de mariage, la coupe était pleine et elle avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre dans un gîte d’une amie d’enfance, pas très loin des frères Lacour : Richard et Daniel. Ça faisait longtemps qu’elle ne les voyait plus, elle s’en voulait. Les choses allaient changer.
Vladimir donc, est embauché par la scierie. Non déclaré, il loge dans une caravane vétuste sans aucune commodité, mais il a l’habitude et se contente de ce qu’il a jusqu'au jour où les frères Lacour viennent lui témoigner quelques signes d’amitié et finissent par lui proposer d’aménager sur leurs terres, dans une cabane à remettre en état, au fond du Val Triste, à quelques kilomètres de leur ferme.
« Une tanière toute en rondins de pins mal équarris, adossée à la forêt et donnant sur une clairière avec une vaste prairie où serpentait un ruisseau qui prenait sa source en haut du vallon. L’eau y était fraîche même en été et elle avait un léger goût de rouille. »
Vladimir ne se doute pas qu’il va préparer là un nid d’amour pour une fée d’hiver.
André Bucher à l’art de communiquer la nature, les sentiments qu’elle provoque et même ses propres sentiments à elle en tant qu’entité vivante à part entière et ce, d’une façon totalement originale, des images non attendues qui donnent beaucoup de fraicheur à l’écriture d’une histoire elle-même captivante, toute pleine de rebondissements, de profondeur, d’humanité et de rage aussi. Ce roman est un torrent de montagne à glisser à votre chevet.
Cathy Garcia Canalès
Écrivain, paysan, bûcheron, André Bucher est né en 1946 à Mulhouse, Haut-Rhin. Après avoir exercé mille métiers (docker, berger, ouvrier agricole…), il s’était installé à Montfroc en 1975, vallée du Jabron, dans la Drôme, où il est décédé des suites d’une maladie le 1er octobre 2022. Il était l’un des pionniers de l’agriculture bio en France. Écrivain des grands espaces, lecteur de Jim Harrison, Rick Bass, Richard Ford…, des écrivains amérindiens tels James Welch, Louise Erdich, Sherman Alexie, David Treuer…, son écriture puise sa scansion, sa rythmique dans le blues, la poésie, le jazz et le rock’n’roll. La nature n’est pas un décor mais un personnage de ses histoires. Fée d’hiver est son sixième roman.
Le regard aussi est un toucher.
in La vallée seule
Bibliographie :
Tordre la douleur, roman, Le Mot et le Reste, janvier 2021.
Un court instant de grâce, roman, Le Mot et le Reste, 2018.
À l'écart, récit, Le Mot et le Reste, 2016.
La Montagne de la dernière chance, roman, Le Mot et le Reste, 2015.
Confidences de l'oreille blanche, conversation entre André Bucher et Benoît Pupier, Revue critique de fixxion française contemporaine n°1, Écopoétiques, mars 2015.
La Vallée seule, roman, Le Mot et le Reste, 2013.
Histoire de la neige assoupie, Une hirondelle qui pleure tout le temps (nouvelles), Chiendents n°17, Cahier d’arts et de littératures, André Bucher, Une géographie intime, éditions du Petit Véhicule, 2012.
Fée d’hiver, roman, éditions le mot et le reste, 2012.
La Cascade aux miroirs, roman, Denoël, 2009.
Le Pays de Haute Provence, carnet de voyage, vu de l’intérieur, récit, en collaboration avec le photographe Pascal Valentin, pour l’office de tourisme du Pays de Haute Provence, 2007.
Déneiger le ciel, roman, Sabine Wespieser, 2007.
Pays à vendre, roman, Sabine Wespieser, 2005.
Le Cabaret des oiseaux, roman, Sabine Wespieser, 2004.
Le Pays qui vient de loin, roman, Sabine Wespieser, 2003.
Le Juste Retour des choses, Saint-Germain-des-Prés, Miroir oblique, 1974.
Le Retour au disloqué, récit, Publication par l’auteur, 1973.
La Lueur du phare II, Éditions de la Grisière / Éditions Saint-Germain-des-Prés, Balises, 1971.
La Fin de la nuit suivi de Voyages, J. Grassin,1970.

Il songea que les empreintes des animaux dessinaient régulièrement des courbes ou des cercles. Les plantes également décrivaient des ronds pour se multiplier. Il n'y avait, selon lui, que l'homme pour se diminuer en s'imposant de vivre, et parfois de penser, à l'intérieur de carrés ou de rectangles. En y réfléchissant, il constata qu'il n'existait, pour ainsi dire, aucun carré dans la nature. Que l'on considérât la terre, la lune, le soleil ou l’œuf, ou encore les nids.
André Bucher in Déneiger le ciel