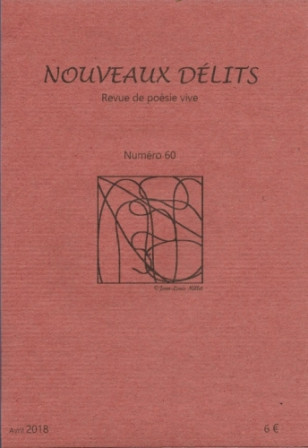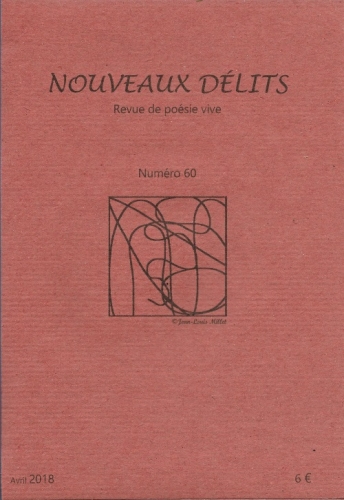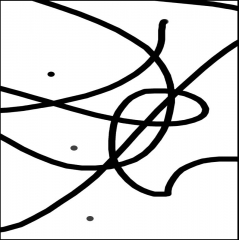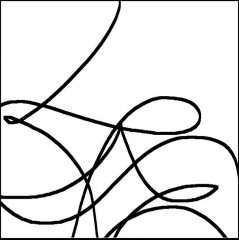La ballata del Fantozzi - Paolo Villaggio
BALLATA DEGLI INESISTENTI
Potrei tentare di narrarvi
al suono della mia tastiera
come Baasima morì di lebbra
senza mai raggiunger la frontiera,
o come l’armeno Méroujan
sotto uno sventolio di mezzelune
sentì svanire l’aria dai suoi occhi
buttati via in una fossa comune;
Charlee, che travasata a Brisbane
in cerca di un mondo migliore,
concluse il viaggio
dentro le fauci di un alligatore,
o Aurélio, chiamato Bruna
che dopo otto mesi d’ospedale
morì di aidiesse contratto
a battere su una tangenziale.
Nessuno si ricorderà di Yehoudith,
delle sue labbra rosse carminio,
finite a bere veleni tossici
in un campo di sterminio,
o di Eerikki, dalla barba rossa, che,
sconfitto dalla smania di navigare,
dorme, raschiato dalle orche,
sui fondi d’un qualche mare;
la testa di Sandrine, duchessa
di Borgogna, udì rumor di festa
cadendo dalla lama d’una ghigliottina
in una cesta,
e Daisuke, moderno samurai,
del motore d’un aereo contava i giri
trasumanando un gesto da kamikaze
in harakiri.
Potrei starvi a raccontare
nell’afa d’una notte d’estate
come Iris ed Anthia, bimbe spartane
dacché deformi furono abbandonate,
o come Deendayal schiattò di stenti
imputabile dell’unico reato
di vivere una vita da intoccabile
senza mai essersi ribellato;
Ituha, ragazza indiana,
che, minacciata da un coltello,
finì a danzare con Manitou
nelle anticamere di un bordello,
e Luther, nato nel Lancashire,
che, liberato dal mestiere d’accattone,
fu messo a morire da sua maestà britannica
nelle miniere di carbone.
Chi si ricorderà di Itzayana,
e della sua famiglia massacrata
in un villaggio ai margini del Messico
dall’esercito di Carranza in ritirata,
e chi di Idris, africano ribelle,
tramortito dallo shock e dalle ustioni
mentre, indomito al dominio coloniale,
cercava di rubare un camion di munizioni;
Shahdi, volò alta nel cielo
sulle aste della verde rivoluzione,
atterrando a Teheran, le ali dilaniate
da un colpo di cannone,
e Tikhomir, muratore ceceno,
che rovinò tra i volti indifferenti
a terra dal tetto del Mausoleo
di Lenin, senza commenti.
Questi miei oggetti di racconto
fratti a frammenti di inesistenza
trasmettano suoni distanti
di resistenza.
[Scarti di magazzino, 2013]
*
BALLADE DES INEXISTANTS
Je pourrais tenter de vous conter
au son de mon clavier
comment Baasima mourut de la lèpre
sans jamais atteindre la frontière,
ou comment l’arménien Méroujan
sous un flottement de demi-lunes
sentit s’évanouir l’air de ses yeux
jetés dans une fosse commune;
Charlee, qui transvasée à Brisbane
en quête d’un monde meilleur,
conclut le voyage
dans la gueule d’un alligator,
ou Aurélio, nommée Bruna
qui après huit mois d’hôpital
mourut de sidaïe contractée
après s’être battu sur un périphérique.
Personne ne se rappellera Yehoudith,
ses lèvres rouges carmin,
effacées à boire des poisons toxiques
dans un camp d’extermination,
ou Eerikki, à la barbe rouge,
vaincu par l’agitation des flots,
qui dort, récuré par les orques,
sur les fonds de quelque mer;
la tête de Sandrine, duchesse
de Bourgogne entendit la rumeur de la fête
en tombant de la lame d’une guillotine
dans un panier
et Daisuke, samurai moderne,
comptait les tours du moteur d’un avion
transcendant un geste de kamikaze en harakiri.
Je pourrais rester à raconter
dans la chaleur étouffante d’une nuit d’été
comment Iris et Anthia, enfants spartiates
difformes furent abandonnées,
ou comment Deendayal creva de privations
imputables au crime unique
de vivre une vie de paria
sans jamais s’être rebellé;
Ituha, fille indienne,
menacée d’un couteau,
qui finit par danser avec un Manitou
dans l’antichambre d’un bordel
et Luther, né dans le Lancashire
libéré du métier de mendiant,
et forcé de mourir par sa majesté britannique
dans les mines de charbon.
Qui se souviendra d’Itzayana,
et de sa famille massacrée
dans un village aux marges du Mexique
par l’armée de Carranza en retraite,
et quoi d’Idris, africain rebelle,
assommé de chocs et de brûlures
alors qu’indompté par la domination coloniale,
il tâchait de voler un camion de munitions;
Shahdi vola haut dans le ciel
au-dessus des hampes de la révolution verte,
atterrissant à Téhéran, les ailes déchiquetées
par un coup de canon,
et Tikhomir, maçon tchétchène,
s’abîma devant les visages indifférents
sur la terre du toit du Mausolée
de Lénine, sans commentaires.
Des objets de récit
fractures aux fragments d’inexistence
qui transmettent des sons lointains
de résistance.
[Déchets de magasin, 2013]
traduction de Pierre Lamarque
https://independent.academia.edu/IvanPozzoni















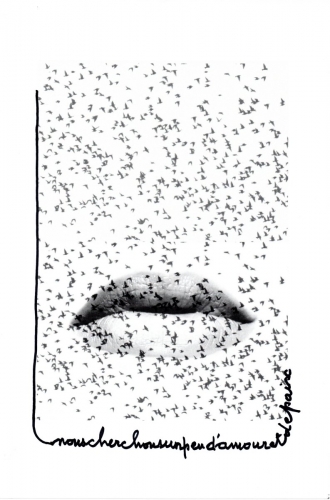

 Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (
Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (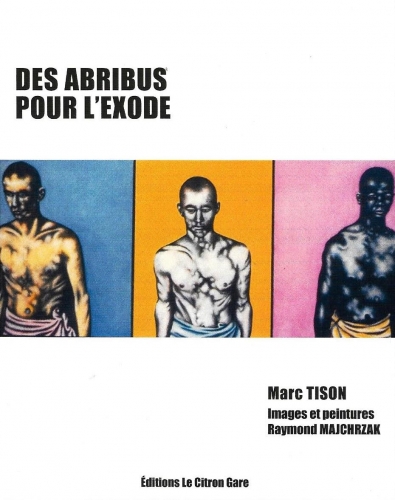
 Marc Tison
Marc Tison